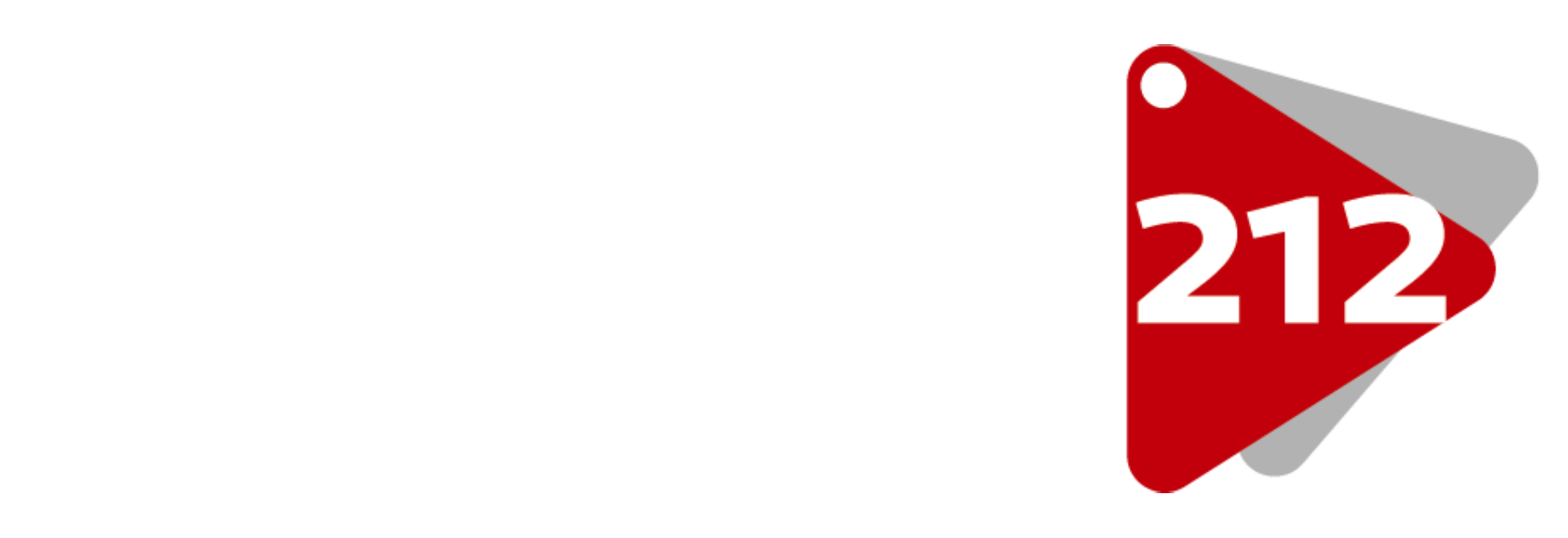Les femmes marocaines résidant à l’étranger jouent un rôle essentiel au sein de la diaspora marocaine, contribuant de manière significative aux économies de leurs pays d’accueil tout en enrichissant le tissu socio-économique du Maroc. Cependant, derrière ces contributions se cachent des parcours souvent semés d’embûches. Entre discriminations, barrières culturelles et pressions familiales, ces femmes font preuve d’une résilience exceptionnelle pour s’imposer dans le monde professionnel. Elles ne se font pas remarquer par des revendications bruyantes, elles agissent avec détermination. Invisibles dans les statistiques, elles sont pourtant des forces puissantes dans l’ombre. Entre sacrifices et réussites, les femmes marocaines de la diaspora dessinent les contours d’un Maroc connecté au monde.
Une force invisible mais essentielle
Les Marocains Résidant à l’Étranger sont souvent perçus comme un « atout stratégique » pour le Royaume. Cependant, ce qui est rarement abordé, c’est la moitié discrète mais puissante de cette diaspora : les femmes. Selon les dernières données de la Fondation Hassan II pour les MRE, elles représentent plus de 52 % de la population expatriée, soit plus d’une Marocaine sur deux vivant à l’étranger. Ce chiffre, à la fois discret et révélateur, cache un potentiel immense, souvent ignoré par les politiques publiques et les médias.
Ces femmes ont quitté le Maroc pour diverses raisons : études, mariage, évasion de la précarité ou simplement la quête d’une vie meilleure. Mais une fois arrivées à destination, elles n’ont jamais cessé de garder le lien avec leur pays d’origine, même si celui-ci semble parfois les avoir oubliées. À travers leurs envois d’argent, leurs investissements, leurs échanges culturels, ou encore leur rôle de mères et d’éducatrices, elles contribuent quotidiennement à faire vivre un Maroc qui s’étend bien au-delà de ses frontières géographiques.
Double identité, double combat
Être une femme marocaine à l’étranger, c’est souvent porter deux fois le poids des discriminations : celle liée au genre et celle liée à l’origine. Dans de nombreux pays d’accueil, ces femmes doivent continuellement faire leurs preuves, justifier leur compétence, affirmer leur identité sans l’imposer et se défendre sans paraître agressives. Un équilibre fragile, presque impossible.
Prenons l’exemple de Nadia, arrivée en Belgique à 25 ans, titulaire d’une licence en droit. On lui a proposé de faire le ménage dans des bureaux. « Je n’ai pas honte d’avoir commencé là. Ce qui me révolte, c’est qu’on n’ait vu en moi qu’une femme arabe, pas une juriste compétente. » Aujourd’hui avocate, Nadia incarne cette résilience tenace, cette volonté farouche de ne pas se laisser enfermer dans les stéréotypes.
Les études confirment ces réalités : selon l’Institut Montaigne, les femmes issues de l’immigration maghrébine en Europe sont deux fois plus susceptibles d’être discriminées que leurs homologues masculins. Et cela, même lorsqu’elles ont un niveau d’étude équivalent, voire supérieur.
Des métiers essentiels, mais peu valorisés
Malgré les diplômes et les ambitions, beaucoup de femmes marocaines de la diaspora se retrouvent cantonnées à des secteurs historiquement féminisés, précaires, voire invisibilisés : aides-soignantes, auxiliaires de vie, femmes de ménage, nounous, cuisinières… Elles sont nombreuses dans les hôpitaux, les écoles et les maisons de retraite, là où l’humain a besoin de soin.
Au Canada, Statistique Canada note que près de 30 % des marocaines immigrées travaillent dans la santé ou les services à la personne, souvent dans des conditions difficiles, sans reconnaissance sociale ni progression professionnelle.
Et pourtant, ce sont elles qui ont tenu les pays debout pendant la pandémie. Elles étaient en première ligne, sans gilet pare-balles, ni micros devant elles. Et après la crise, elles sont retournées à l’ombre, oubliées.
Une nouvelle génération d’entrepreneures audacieuses
Mais une révolution silencieuse s’opère. Portées par le numérique, les réseaux sociaux, l’accès à la formation en ligne et une volonté d’indépendance farouche, de plus en plus de marocaines MRE se lancent dans l’entrepreneuriat. Elles créent des marques de mode, des cabinets de conseil, des start-up tech, des salons de beauté, des agences de voyage ou de coaching, souvent en lien avec leur double culture.
Fatima, 43 ans, installée à Barcelone, a lancé une boutique de caftans en ligne. « J’ai commencé avec 300 euros. Aujourd’hui, je vends en France, en Belgique et au Qatar. Je fais rayonner l’artisanat marocain en l’adaptant aux codes modernes. »
Cette vague d’entrepreneuriat féminin ne se contente pas de créer de la valeur économique. Elle redessine l’image de la femme marocaine à l’étranger : ambitieuse, créative, indépendanteet connectée.
Investir dans le pays d’origine : entre amour et désillusion
L’attachement au Maroc reste profond. Chaque été, des milliers de femmes MRE reviennent au pays, parfois au prix de longues heures de route, de trajets avec enfants et des valises chargées. Mais ce n’est pas qu’un retour affectif : ces femmes investissent.
Elles construisent des maisons, soutiennent des projets agricoles, financent des écoles etparticipent à l’économie locale, souvent en toute discrétion.
En 2022, les transferts des MRE ont atteint plus de 6,2 milliards de dollars, selon la Banque mondiale. Même si les statistiques genrées manquent, une part importante de ces transferts provient des femmes.
Pourtant, elles se heurtent à la lenteur de l’administration, à la méfiance des partenaires locaux, au manque d’accompagnement spécifique. Samira, installée à Rotterdam, voulait lancer un projet touristique dans le sud du Maroc : « J’ai abandonné. Trop de paperasse, pas assez de considération. On veut notre argent, mais pas nos idées. »
Le rôle invisible mais fondamental de passeuses de culture
Dans l’intimité des foyers, les femmes MRE sont les gardiennes du lien vivant avec leur pays d’origine. Elles transmettent non seulement la langue arabe, mais aussi les traditions, la cuisine, les fêtes religieuses, et les chansons populaires. À travers leurs gestes quotidiens, elles traduisent le Maroc à leurs enfants, tout en les préparant à naviguer dans un monde globalisé.
« Je fais le couscous tous les vendredis, même à Londres. Mes filles le feront pour leurs enfants. C’est ainsi que je garde le lien avec notre culture », confie Loubna, 50 ans.
Ce travail, souvent invisible, de transmission culturelle joue un rôle clé dans la préservation de l’identité des diasporas, mais il demeure malheureusement trop rarement valorisé à sa juste mesure.
Des actrices invisibles dans les sphères décisionnelles
Aucune transformation durable dans les politiques migratoires ne pourra se réaliser sans l’inclusion active de ces femmes. Pourtant, elles sont largement absentes des espaces décisionnels, des instances de consultation, des campagnes de communication et des projets structurants dédiés à la diaspora.
Des collectifs féminins, tels que « Femmes MRE en Mouvement », ainsi que des réseaux professionnels dédiés aux femmes marocaines vivant à l’étranger, notamment au Canada et en France, luttent pour faire entendre leur voix, mais les obstacles demeurent nombreux.
Ces femmes revendiquent une représentation accrue dans les ambassades, une écoute réelle dans l’élaboration des politiques migratoires, ainsi qu’un soutien renforcé dans leurs démarches de retour ou d’investissement. Et surtout, elles demandent la fin d’un regard paternaliste, préférant un partenariat authentique fondé sur le respect et l’autonomie.
Ambassadrices du Maroc à l’international
Ces femmes, par leur parcours, incarnent le Maroc de demain. Polyglottes et habiles dans la navigation entre différentes cultures, elles évoluent dans des environnements divers et complexes. Véritables ambassadrices du Maroc, elles incarnent la richesse du patrimoine marocain à travers leur éthique, leurs réussites professionnelles et leur ouverture d’esprit.
Actrices incontournables dans leur pays d’accueil, elles participent activement à des forums internationaux, prennent la parole lors de conférences prestigieuses, et s’investissent dans des programmes de mentorat qui permettent de transmettre leur savoir-faire et leurs expériences aux générations futures. Leur impact dépasse celui des institutions marocaines : elles portent le Maroc autrement. Non pas à travers des discours institutionnels, mais par des actions tangibles, des initiatives locales qui font rayonner le pays à travers leurs récits partagés, leurs projets entrepreneuriaux et leurs engagements sociaux. En se rendant visibles dans des espaces de pouvoir et de décision, elles contribuent à redéfinir l’image du Maroc dans le monde, loin des stéréotypes et des attentes traditionnelles.
Ce qu’elles veulent, ce n’est pas de la charité, mais un partenariat
Les femmes marocaines de la diaspora ne cherchent pas la compassion. Ce qu’elles veulent, c’est qu’on leur donne les outils nécessaires, qu’on reconnaisse leurs contributions et qu’on établisse des ponts institutionnels solides. Elles sont un réservoir de compétences, de talents et d’expériences multiculturelles, prêtes à jouer un rôle clé dans l’émergence d’un Maroc plus moderne, inclusif et rayonnant à l’international.
Il est temps donc de revoir le regard qu’on porte sur elles. Plutôt que de leur tendre la main par charité, offrons-leur l’opportunité d’avancer ensemble, en tant qu’actrices de changement et de progrès.