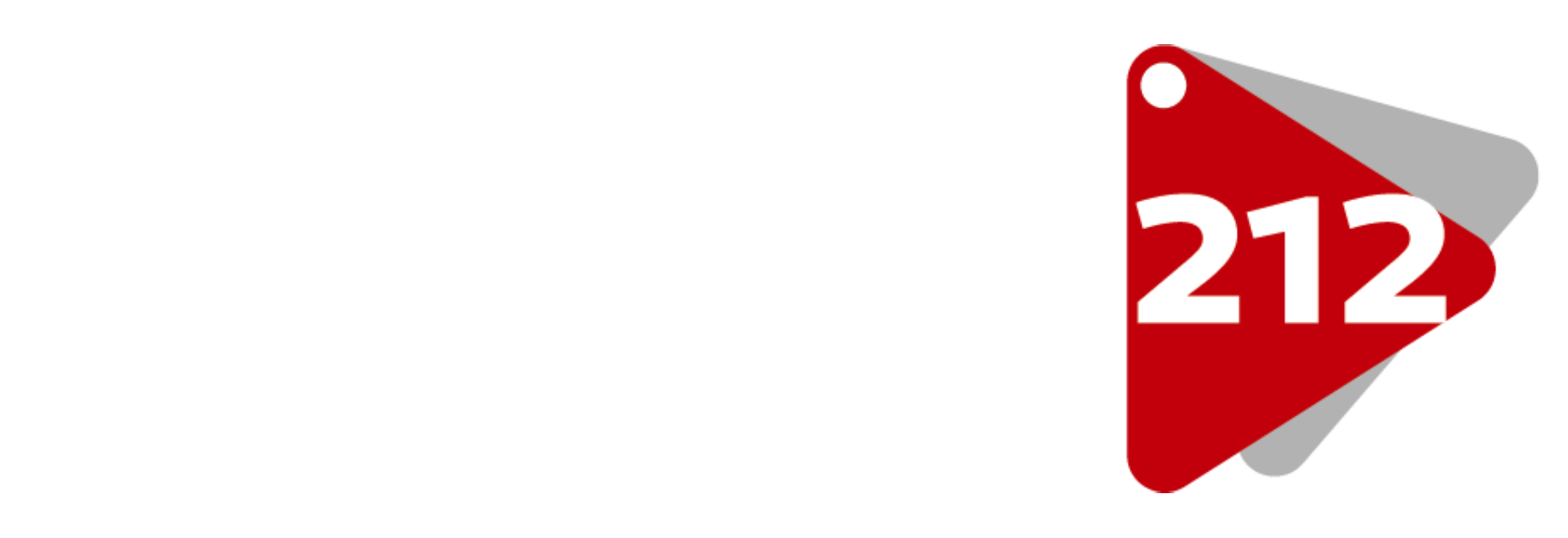Dans un contexte de changement climatique de plus en plus pressant, des agriculteurs français du Roussillon expérimentent une culture pour le moins singulière : l’arganier. Originaire du sud-ouest du Maroc et véritable symbole écologique et culturel du royaume, cet arbre emblématique trouve désormais racine à Baixas, dans les Pyrénées-Orientales. Portée par un collectif de viticulteurs locaux, cette initiative vise à tester la viabilité de cultures adaptées aux conditions climatiques arides qui frappent le sud de la France.
Face à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, les agriculteurs cherchent des solutions innovantes pour garantir la pérennité de leur activité. L’arganier, réputé pour sa résistance exceptionnelle à la sécheresse, il se contente d’environ 250 millimètres d’eau par an, semble être une option prometteuse. «C’est une plante très résistante à la sécheresse et qui, on l’espère, va produire», déclare Vincent Connes, l’un des viticulteurs engagés dans le projet.
Mais si l’expérience agricole peut paraître logique sur le plan agronomique, elle soulève aussi certaines interrogations, notamment au Maroc. L’arganier, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO est bien plus qu’un simple arbre. Il représente un héritage ancestral, lié au savoir-faire des femmes berbères du Souss, qui en extraient une huile précieuse aux multiples usages, économiques, culinaires et médicinaux.
Certains observateurs marocains et membres de la société civile dénoncent déjà ce qu’ils perçoivent comme une forme “d’appropriation culturelle végétale“, d’autant plus que les bénéfices futurs de cette expérimentation pourraient échapper aux communautés marocaines historiquement liées à cette culture.
Du côté français, on met plutôt en avant une démarche d’innovation et de coopération. Le collectif ne s’est pas limité à l’arganier. Il teste également d’autres espèces capables de s’épanouir en climat semi-aride, comme le figuier de Barbarie, le tea-tree, l’aloe vera ou encore le poivrier. L’idée est de bâtir un nouveau modèle agricole plus résilient, en s’inspirant des pratiques en vigueur dans d’autres régions du pourtour méditerranéen, y compris au Maroc.
« On part du principe qu’on va s’adapter au climat et non l’inverse », explique Vincent Connes. Une logique qui s’inscrit dans une démarche d’anticipation écologique, mais qui ne saurait faire l’économie d’un débat sur le respect du patrimoine végétal et culturel des pays du Sud.
Alors, innovation responsable ou exploitation silencieuse ? La question mérite d’être posée, à l’heure où les enjeux liés au climat se croisent de plus en plus avec ceux de la souveraineté écologique et culturelle.